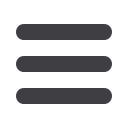
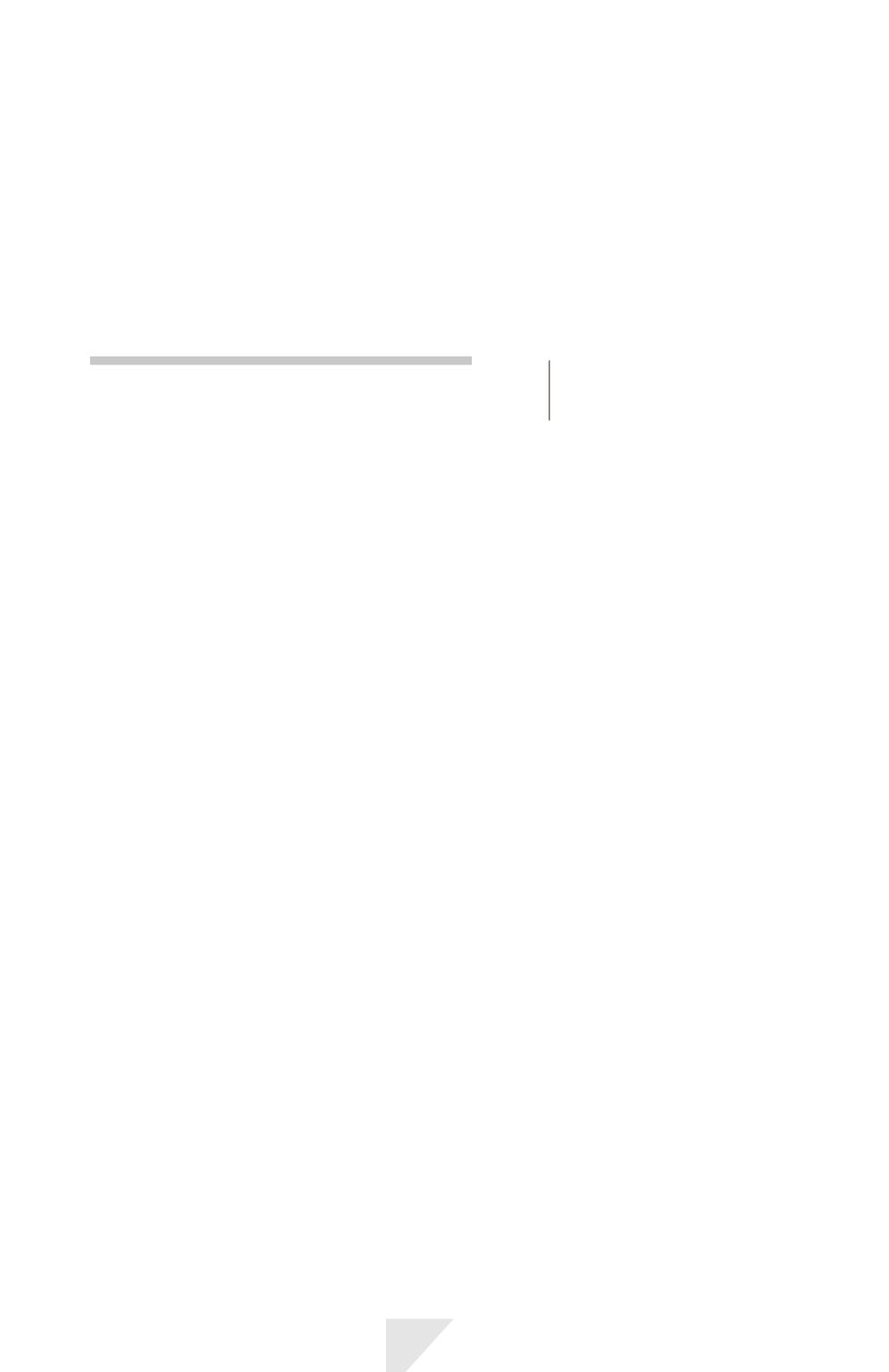
Passifs
296
> Comptabilisation des régimes à cotisations définies
La comptabilisation des régimes à cotisations définies est relativement simple,
compte tenu de la nature de ces régimes : cotisations fixes par une entreprise
à un organisme distinct, avec transfert des risques actuariels et de placement.
Quand un employé a rendu service à une entreprise sur une période donnée,
l’entité bénéficiaire du service doit enregistrer sur la même période les cotisa-
tions définies en échange de ces services :
Charges
(*)
.........................................................................
Dette........................................................................
X
X
(*)
À moins qu’une autre norme du référentiel IFRS préconise un traitement différent (par exemple IAS 2,
incorporation de dépenses au coût des stocks).
Si les cotisations à ce type de plan n’interviennent pas dans les 12 mois qui sui-
vent la fin de la période où l’employé a généré ce droit par un service rendu,
elles doivent être actualisées au taux de rendement du marché des obligations
de haute qualité.
Exemple : cotisations patronales de retraite en France.
> Comptabilisation des régimes à prestations définies
La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe en raison de
la difficulté d’évaluation du passif afférent. La norme IAS 19 encourage les entre-
prises (sans toutefois le leur imposer) à faire appel à un actuaire pour évaluer les
obligations significatives au titre des avantages postérieurs à l’emploi.
- Éléments constitutifs de l’évaluation de l’obligation
L’évaluation et la comptabilisation des régimes à prestations définies
requièrent d’effectuer séparément pour chaque régime significatif les opé-
rations suivantes :
a) Estimer par des techniques actuarielles les avantages accumulés ;
b) Actualiser les prestations par la méthode des unités de crédit projetées
et déterminer la valeur actuelle de l’obligation et le coût des services ren-
dus au cours de la période ;
c) Déterminer la juste valeur des actifs du régime ;
d) Tenir compte, le cas échéant, du plafond de l’actif ;
e) et f) Déterminer les montants à comptabiliser en résultat net [coût des
services rendus au cours de la période, coûts des services passés et pro-
fit ou perte résultant d’une liquidation le cas échéant, intérêts nets sur le
passif (l’actif) net au titre des prestations définies] ;
g) Déterminer les montants à comptabiliser en autres éléments du résul-
tat global résultant des réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des
prestations définies (écarts actuariels, rendement des actifs du régime à
l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets
















