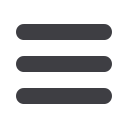

50
CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Les rendements (returns) varient avec les activités de l’entité et peuvent être positifs
ou négatifs (voire être alternativement positifs et négatifs), et peu importe la nature
juridique des rendements.
Les « rendements », au sens de la norme IFRS, sont définis de manière très large
et incluent notamment :
- les dividendes (et autres distributions réalisées par une filiale), et les changements
dans la valeur de la filiale ;
- les revenus au titre de prestations de services, l’accès à de la trésorerie, les
économies d’impôts, ... ;
- les rendements qui ne sont pas accessibles aux autres actionnaires (économies
d’échelle, synergies, accès à des ressources rares, ...).
Ainsi, en pratique, une obligation à taux fixe est considérée exposer le porteur à des
droits à une exposition à des rendements variables car le porteur est soumis, pour
le paiement des intérêts, au risque de crédit de l’entité.
De même, des honoraires fixes de gestion d’un actif sont également considérés
comme des rendements variables.
Le lien entre pouvoir et rendements ne signifie pas que la fraction des rendements
de l’entité revenant à l’investisseur doit être parfaitement en ligne avec le niveau
de pouvoir dont il dispose, mais simplement que la société mère doit disposer de la
capacité d’influer sur les rendements de l’entité pour elle-même.
4 - Lien entre pouvoir et rendement
Le contrôle de l’entité sur une autre nécessite non seulement que l’entité ait le pou-
voir sur l’autre entité et qu’elle soit exposée ou ait des droits aux rendements que
celle-ci procure mais aussi qu’elle ait la faculté d’utiliser son pouvoir pour influer sur
les rendements procurés par l’autre entité grâce à son implication dans celle-ci.
Il en résulte qu’une entité gestionnaire ayant des pouvoirs de décision sur une entité,
mais qui n’est pas exposée ou n’a pas de droits aux rendements procurés par cette
entité, ne dispose pas du contrôle sur celle-ci. Elle agit pour le compte d’un tiers.
Ainsi, tout gestionnaire doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou pour le
compte d’un tiers.
Plus l’ensemble de ses intérêts économiques y compris sa rémunération et leur
variabilité sont importants, plus il est probable que le détenteur des pouvoirs de
décision agit pour son propre compte.
Il convient d’examiner également si l’exposition à la variabilité des avantages du
détenteur de pouvoirs de décision est différente de celle des autres investisseurs et,
si oui, de quelle manière cette circonstance peut influer sur ses actes.
Tel est le cas d’un détenteur de pouvoirs de décision dont les intérêts dans l’entité
passent au second rang par rapport à ceux des autres investisseurs ou qui a con-
senti à l’entité d’autres formes d’amélioration de son risque de crédit.
Exemple 2
Un décideur (gestionnaire de fonds) constitue, commercialise et gère un fonds
réglementé dont les parts sont négociées sur le marché, conformément à des
paramètres définis étroitement dans le mandat de placement, comme l’exigent les
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le fonds a été présenté aux inves-
tisseurs comme un placement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux
propres d’entités cotées.
Dans le respect des paramètres définis, le gestionnaire du fonds choisit à sa dis-
crétion les actifs dans lesquels investir. Il a fait un placement au pro rata de 10 %
















