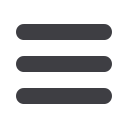
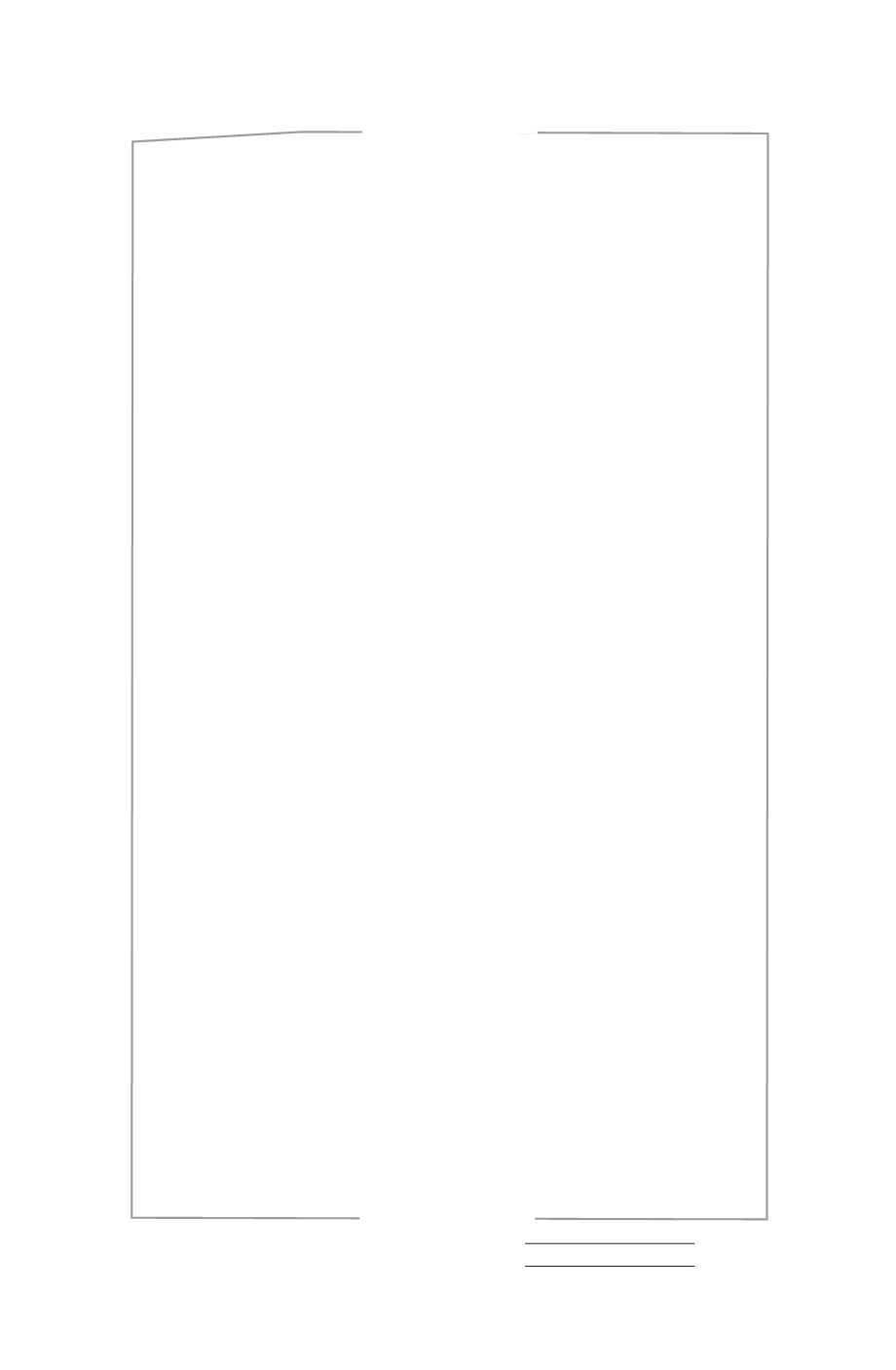
Lorsqu’un partenariat peut être structuré sous forme de véhicule distinct, c’est-à-
dire une structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une
entité juridique distincte, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.
Dans ce cas, l’accord contractuel est dans certains cas incorporé en tout ou partie
dans les statuts, la charte ou tout autre acte constitutif du véhicule distinct.
L’accord contractuel définit les conditions selon lesquelles les parties participent à
l’activité constituant l’objet de l’opération. Il porte généralement sur des points tels
que :
- l’objet, l’activité et la durée du partenariat ;
- le mode de désignation des membres du conseil d’administration (ou d’un
organe de direction équivalent) du partenariat ;
- le processus décisionnel : les questions nécessitant la prise de décisions de la
part des parties, les droits de vote des parties et le niveau de soutien requis sur ces
questions. Le processus décisionnel défini dans l’accord contractuel établit le contrôle
conjoint sur l’opération ;
- l’apport en capital ou les autres apports exigés des parties ;
- les modalités de partage des actifs, des passifs, des produits, des charges ou du
résultat net relatifs au partenariat.
B
- D
ÉMONTRER
LE
CONTRÔLE
CONJOINT
L’entité qui est partie à une opération doit déterminer si l’accord contractuel confère
à toutes les parties, ou à un groupe d’entre elles, le contrôle collectif de l’opération.
Il y a contrôle collectif lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, doivent
agir de concert pour diriger les activités qui ont une incidence importante sur les
rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes).
Une fois qu’elle a déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles,
contrôlent collectivement l’opération, l’entité doit déterminer si elle exerce un con-
trôle conjoint sur l’opération. Le contrôle conjoint n’existe que dans le cas où les
décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime
des parties qui contrôlent collectivement l’opération. La question de savoir si une
opération est contrôlée conjointement par toutes les parties à l’opération, ou par
un groupe d’entre elles, ou si elle est contrôlée par une seule des parties peut
nécessiter l’exercice du jugement.
Parfois, le processus décisionnel convenu entre les parties dans leur accord con-
tractuel donne implicitement lieu à un contrôle conjoint. Prenons par exemple le
cas où deux parties mettent en place une opération dans laquelle chacune détient
50 % des droits de vote ; l’accord contractuel stipule que les décisions concernant
les activités pertinentes sont prises à au moins 51 % des droits de vote. Dans ce
cas, les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint sur
l’opération, car les décisions concernant les activités pertinentes ne peuvent être
prises sans le consentement des deux parties.
Dans un partenariat, aucune des parties n’exerce un contrôle unilatéral sur l’opé-
ration. Toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher le
contrôle de celle-ci par une autre partie ou par un groupe de parties.
Une opération peut être un partenariat même si toutes les parties à l’opération
n’exercent pas sur celle-ci un contrôle conjoint. La présente norme établit une
distinction entre les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat
(coparticipants ou coentrepreneurs) et les parties qui participent au partenariat
sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci.
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE
55
















