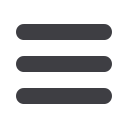

2 - Type du partenariat
Dans un second temps, l’entité doit déterminer le type de partenariat auquel elle
participe.
Des partenariats sont établis pour diverses raisons (par exemple comme moyen
de partager des coûts et des risques entre les parties ou de leur permettre d’avoir
accès à de nouvelles technologies ou à de nouveaux marchés) et peuvent revêtir
différentes structures et formes juridiques.
Certains partenariats ne nécessitent pas que l’activité qui en constitue l’objet soit
réalisée au moyen d’un véhicule distinct. D’autres, en revanche, impliquent la créa-
tion d’un véhicule distinct.
La norme distingue deux types de partenariats : l’activité conjointe et la coentre-
prise.
A
- A
CTIVITÉ
CONJOINTE
(
OU
JOINT
OPÉRATION
)
Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un
contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au
titre des passifs, relatifs à celle-ci. Ces parties sont appelées coparticipants.
B
- U
NE
COENTREPRISE
(
OU
JOINT
VENTURE
)
Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Ces parties sont
appelées coentrepreneurs.
3 - Classement d’un partenariat
L’appréciation des droits et obligations provenant d’un partenariat, afin de détermi-
ner s’il s’agit d’une opération conjointe ou d’une entité conjointe, est effectuée en
considérant les aspects suivants :
- la structure du partenariat ;
- lorsque le partenariat prend la forme d’une entité, la forme juridique de celle-ci,
les dispositions de l’accord et tout autre fait ou circonstances utiles.
A
- S
TRUCTURE
DU
PARTENARIAT
Partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct
Un partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct est une activité con-
jointe. Dans ce cas, l’accord contractuel établit les droits des parties sur les actifs,
et leurs obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, ainsi que leurs droits
sur les produits correspondants et leurs obligations au titre des charges correspon-
dantes.
L’accord contractuel décrit souvent la nature des activités qui constituent l’objet de
l’opération ainsi que la façon dont les parties ont l’intention de réaliser ces activités
ensemble. Par exemple, les parties à un partenariat pourraient convenir de fabri-
quer ensemble un produit, chaque partie étant responsable de la réalisation d’une
tâche définie et chacune utilisant ses propres actifs et assumant ses propres passifs.
L’accord contractuel pourrait également préciser les modalités du partage entre
les parties des produits et charges qui leur sont communs. Dans ce cas, chaque
coparticipant comptabilise dans ses états financiers les actifs et passifs se rappor-
tant à sa tâche définie et comptabilise sa quote-part des produits et des charges
conformément à l’accord contractuel.
Par ailleurs, les parties à une activité conjointe pourraient convenir, par exemple, de
partager un actif et de l’exploiter ensemble. Dans ce cas, l’accord contractuel définit
les droits des parties sur l’actif exploité conjointement, de même que les modalités
du partage entre les parties de la production ou des produits générés par l’actif ainsi
DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE
57
















